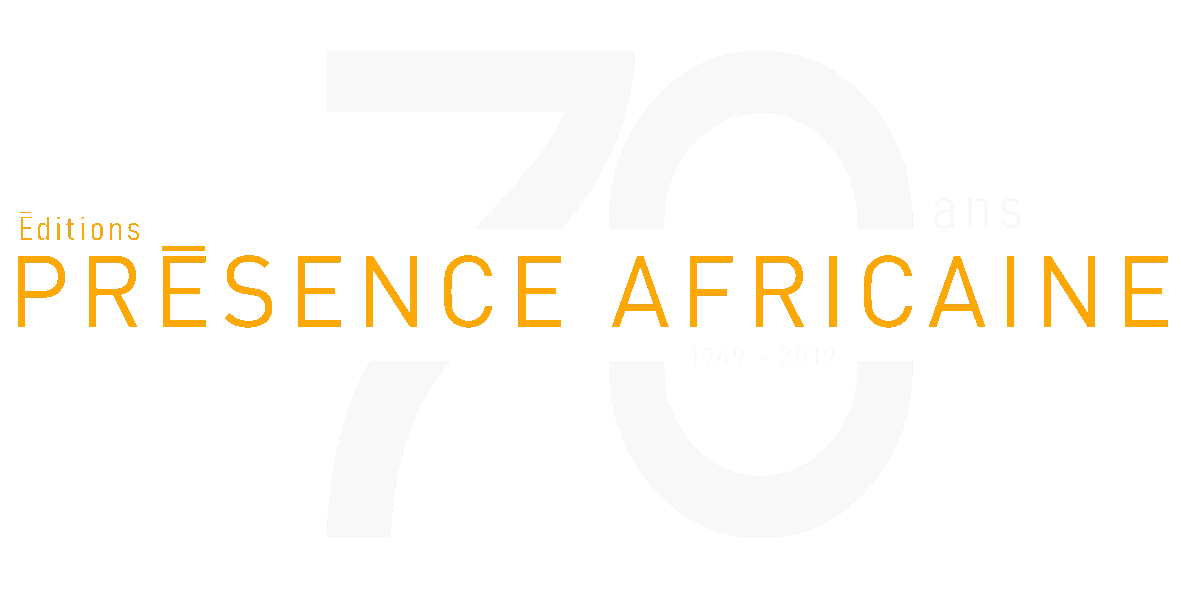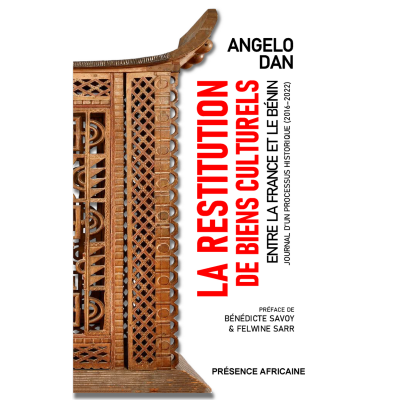- label Revue de presse
- favorite 1 likes
- remove_red_eye 378 vues
Restitution des biens culturels : « Entre la France et le Bénin, le processus est loin d’être achevé »
L’ACTU VUE PAR – Le diplomate béninois Angelo Dan a été au cœur des discussions entre Paris et Cotonou. Il se félicite qu’un tabou ait été levé, pour permettre aux Africains de se réapproprier un patrimoine dispersé à travers le monde à l’époque coloniale.
Propos recueillis par Mawunyo Hermann Boko
Successivement conseiller politique puis chef de mission adjoint avec rang d’ambassadeur à Paris, Angelo Dan a été en charge de suivre les négociations qui ont eu lieu entre Cotonou et Paris, de 2017 à 2022, lesquelles ont abouti à la restitution en novembre 2021, de 26 trésors royaux emportés lors de la conquête coloniale.
C’est en août 2016 que le Bénin en avait fait la demande officielle à la France. La requête formulée à l’ancienne puissance coloniale avait produit une onde de choc et engendré un mouvement inédit de restitutions entre l’Europe – détentrice d’un nombre important d’artefacts du patrimoine africain – et ses anciennes colonies.
Trois ans après, le diplomate béninois, devenu représentant du Bénin au Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, revient dans un ouvrage La restitution de biens culturels entre la France et le Bénin, journal d’un processus historique, paru le 15 décembre aux éditions Présence africaine – et préfacé par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy – sur les coulisses des discussions entre les deux États. Il a répondu aux questions de Jeune Afrique.
Jeune Afrique : Vous avez été au cœur des négociations entre le Bénin et la France qui ont conduit à la restitution de 26 trésors royaux. Dans votre ouvrage, vous revenez sur ce processus inédit. Pourquoi était-il important de le faire ?
Angelo Dan : J’en ai ressenti la nécessité pour en apprendre davantage au grand public sur ce qu’il s’est réellement passé. Il y a beaucoup de séquences qui ont donné lieu à des communications officielles ou qui ont fait l’objet de nombreux articles de presse. Mais il y a d’autres aspects moins connus, comme par exemple le vif débat parlementaire qui a eu lieu en France entre deux camps aux positions tranchées.
Mon livre est un récit qui permet de documenter le déroulement du processus et d’éclairer sur les difficultés que nous avons rencontrées durant ce travail. Il s’achève sur des perspectives et souligne, à cet égard, que ce processus de restitution des biens culturels est loin d’être achevé.
En août 2016, en demandant officiellement à la France de lui restituer les biens culturels emportés par son armée lors de la conquête coloniale en 1892, le Bénin était-il dans une démarche politique ou dans la revendication ?
Le Bénin est dans une démarche politique quand il adresse sa requête officielle au gouvernement français. Dans cette lettre à son homologue, Aurélien Agbénonci, le ministre béninois des Affaires étrangères d’alors, situe clairement le fondement de sa démarche. Il évoque la valeur historique et spirituelle considérable pour le peuple béninois des œuvres concernées. Il indique qu’elles font partie de notre identité et qu’elles nous permettraient de comprendre notre passé ainsi que notre présent. Il parle de rendre justice au peuple béninois. Mais le président Patrice Talon est allé plus loin, en évoquant des motivations économiques et touristiques pour justifier cette demande de restitutions.
La France, sous la présidence de François Hollande, oppose une fin de non-recevoir à la demande. Mais le sujet est relancé par Emmanuel Macron en novembre 2017. À ce moment-là, Cotonou avait-il abandonné tout espoir de récupérer ses trésors ?
Cotonou n’avait pas abandonné. Le 12 décembre 2016, il y a eu à Paris une rencontre entre les présidents Patrice Talon et François Hollande, lors de laquelle, les deux chefs d’État ont décidé d’ouvrir le dialogue sur cette question. Après cette rencontre, plusieurs échanges techniques ont eu lieu. À l’époque, la France souhaitait mettre en place une coopération muséale et patrimoniale. Mais la position du gouvernement béninois était restée immuable : ce que nous attendions, c’était la restitution de ce dont nous avions été spoliés.
Les discussions se poursuivaient. Sauf que tout cela se passait à la fin du premier mandat de François Hollande, qui avait déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas. À partir de ce moment, côté béninois, nous gardions bien en tête qu’il faudrait composer avec cet aléa politique et que les avancées les plus tangibles ne pouvaient avoir lieu qu’avec son successeur.
Emmanuel Macron va missionner les universitaires Felwine Sarr et Bénédicte Savoy pour mener un travail de réflexion qui doit mener à des propositions concrètes en faveur d’une restitution. Les conclusions du rapport des deux universitaires sont sans appel : il faut rendre les biens culturels.
Les conclusions de leur rapport ont été sans ambiguïté sur la nécessité de restituer rapidement un certain nombre de biens détenus en France, dont ceux constitutifs du trésor royal d’Abomey. Nous les avons accueillies avec beaucoup de satisfaction. En revanche, nous n’avons pas apprécié toute la polémique qu’elles ont déclenchée.
En effet, le travail des universitaires a été violemment critiqué par certains acteurs de la conservation du patrimoine en France…
Dès le départ, les deux auteurs du rapport avaient annoncé leur intention de faire des propositions pour rendre irrévocable l’engagement pris par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou, le 23 novembre 2017, de créer les conditions pour faciliter la restitution définitive ou temporaire du patrimoine africain. Le rapport Savoy-Sarr n’a fait qu’aller dans ce sens, tout en proposant un agenda étalé dans le temps pour la mise en œuvre d’un programme circonstancié de restitutions. Bien évidemment, les acteurs du monde des musées et du patrimoine n’étaient pas très enthousiastes. Peut-être qu’ils ne s’attendaient pas à un parti pris aussi radical du rapport.
Le 10 novembre 2021, les biens réclamés reviennent à Cotonou. Mais la veille, devant la presse française, Patrice Talon se montre peu enthousiaste. Pourquoi ?
Pour le Bénin, cette restitution était une victoire diplomatique. Mais il y a, d’après le rapport Savoy-Sarr, 3 157 biens référencés d’origine béninoise dans le seul musée du Quai Branly à Paris. Par ailleurs, le Bénin et la France ont signé, en décembre 2019 à Cotonou, un programme de travail qui mentionne les tâches à accomplir, comme l’inventaire de l’ensemble des œuvres d’origine béninoise conservées dans les institutions et les musées français dans la perspective de leurs restitutions éventuelles. C’est pourquoi le chef de l’État béninois ne manifeste pas, à ce moment-là, une satisfaction totale puisqu’il y a encore des œuvres majeures qui sont restées en France.
Lesquelles ?
Il y a par exemple la statue du dieu Gou, conservée au Pavillon des Sessions du musée du Louvre. Mais aussi la tablette du Fâ, ou le Kataklé, un siège à trois pieds qui fait partie du trésor royal d’Abomey. Cette dernière œuvre se trouve actuellement en Finlande et fera prochainement l’objet d’une restitution aux autorités béninoises à la suite de la visite de travail effectuée dans ce pays par l’actuel ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, en novembre dernier.
D’autres demandes de restitutions vont-elles suivre ?
Il y aura certainement d’autres épisodes entre la France et le Bénin, maintenant ou plus tard. Le Bénin a fait une demande officielle de restitution de la statue du dieu Gou en 2019, et les échanges sur ce sujet se poursuivent. Il faut garder à l’esprit que nous ne sommes pas dans la revendication, mais plutôt dans le dialogue et la coopération. Comme l’a rappelé le chef de l’État béninois à plusieurs reprises, l’idée n’est pas de prendre toutes les œuvres béninoises détenues en France, mais au moins de récupérer celles qui ont une valeur symbolique majeure pour notre peuple.
Trois ans après le retour des œuvres au Bénin, qu’est-ce que cela a changé dans les relations entre le continent et l’Europe ?
Un tabou a été levé. Depuis trois ans, il y a eu un nombre important de restitutions qui ont eu lieu. Les plus connus sont les bronzes du royaume du Bénin restitués par l’Allemagne, qui a signé un mémorandum bilatéral avec le Nigeria avec, à terme, la promesse de restituer l’intégralité des têtes de bronze. La France va bientôt rendre aussi le “Tambour parleur” à la Côte d’Ivoire. Il y a également la Belgique qui a mis en place avec la RDC un cadre propice à des restitutions. Même au Royaume-Uni, à défaut d’une restitution officielle par le gouvernement britannique, les universités ont rendu certaines des œuvres qui étaient en leur possession. Je dirais qu’en matière de restitutions, le Bénin a été un pionnier, et ce processus est désormais irréversible.
Le 20 décembre, la vente aux enchères d’un sceptre royal ayant appartenu au roi Béhanzin a été suspendue in extremis. Les objets présents dans les collections publiques ou privées sont-ils tous voués à retourner en Afrique ?
À chaque fois qu’un pays concerné en fera la demande, cela donnera lieu à des négociations. La marge de manœuvre des pouvoirs publics est réduite en ce qui concerne les collections privées. Mais les frilosités du marché de l’art ne devraient pas nous empêcher de demander la restitution des œuvres issues de notre patrimoine. Aujourd’hui, les marchands d’art doivent prendre en compte ce contexte.